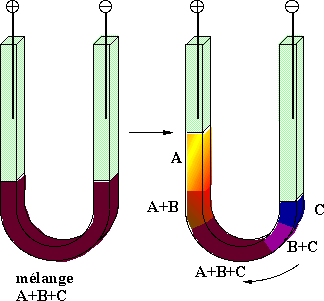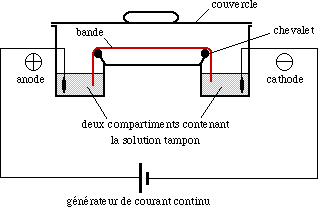C’est donc avec cette mutation que se crée les symptômes chez les personnes atteintes du syndrome de Rett. On peut observer différents niveaux de son phénotype : le macroscopique et le moléculaire. On peut le repérer grâce à différents critères mais aussi la vérifier grâce à l’électrophorèse.
Les différents critères :
Le diagnostic du syndrome de Rett se fait grâce à un examen clinique, car la seule présence d’une mutation au niveau du gène MECP2 ne peut pas causer ce syndrome. Pour trouver les différents critères de diagnostics, il a fallu les définir à plusieurs reprises : en 1985, en 1988, en 2002 et enfin par le groupe d’expert du consortium RettSearch en 2010. Désormais, on repère le syndrome de Rett grâce à une période de régression puis grâce à des critères obligatoires (d'inclusion), facultatifs (de support) et interdits (d'exclusion).
Au niveau macroscopique, on observe donc ces symptômes : le patient ne peut pas parler, utiliser ses mains ou marcher normalement. Le syndrome peut engendrer des problèmes respiratoires, des troubles du sommeil, des tonus musculaires anormaux, une scoliose, un retard de croissance, le refroidissement des mains et des pieds, et une sensibilité réduite face à la douleur chez le patient. Toutefois, si le patient a subi un traumatisme crânien ou a connu un développement psychomoteur anormal pendant les six premiers mois de sa vie, alors il n’est pas atteint du syndrome de Rett. Ces critères ne suffisent donc pas et une étude plus approfondie doit être faite sur l’individu.
L’électrophorèse :
Au niveau du phénotype moléculaire, nous pouvons observer des mutations responsables du syndrome de Rett grâce à l’électrophorèse. En effet, l’électrophorèse permet de distinguer certaines protéines anormales, on parle alors d’électrophorèse de protéines.
C’est une technique permettant de séparer les particules chargées à l’aide d’un champ électrique. Or, ici nous cherchons à distinguer des protéines, donc des molécules. Sachant qu’une molécule est électriquement neutre, On les met donc dans une solution acide, par exemple, pour les charger électriquement (cela rajouterait un ion H+). On parle donc de « molécules chargées ». Mais la molécule, en lui rajoutant un ion, verrait sa masse changer, ce qui est vrai, mais la masse d’un ion est très faible par rapport à celle d’une molécule et par conséquent n’a presque aucune influence sur sa mobilité.
On utilise l’électrophorèse pour constater les excès de production de certaines immunoglobulines (les protéines monoclonales). Elle sert également à constater la pureté des protéines.
Fonctionnement de l’électrophorèse :
Tout d’abord, la technique d’électrophorèse peut être utilisée différemment : l’électrophorèse libre et sur support.
L’électrophorèse libre ne permet pas une séparation totale des protéines, mais est simple à réaliser. Il suffit de mettre le mélange étudié dans un tube en U et de faire passer le courant (+ d’un côté ; - de l’autre), et une séparation se réalisera en fonction de la mobilité des protéines.
Schéma de la démarche de l'électrophorèse libre
L’électrophorèse sur support est bien plus précise et permet de mieux séparer les protéines. En effet, un support poreux (du papier ou du gel homogène) imprégné d’un crée une stabilisation forte et ainsi une séparation plus simple des protéines.
Schéma de l'électrophorèse sur support
Pour ces deux techniques, la séparation se base sur les mêmes principes, la migration électrophorétique. Elle dépend de 5 facteurs :
-
La mobilité électrophorétique (U). Elle crée la charge électrique (Q) et la géométrie de la particule. Quand elle est en contact avec un champ électrique (E), elle subit une force (F) qui la pousse plus ou moins vers l’électrode de signe opposé, on obtient donc : F=Q.E Il faut aussi prendre en compte la viscosité du milieu (V) , la taille (de rayon r) et la vitesse de migration de la particule (v) ; ce qui donne la force de frottement (f) pouvant ralentir les particules. On a donc : f= 6PI. R. v.V Lorsque cela se stabilise, F devient égale à f. La mobilité ( µ) est enfin définit par la relation : µ=v :E
-
Le champ électrique (E) : E=v / µ (vu précédemment)
-
La durée de migration (change la distance parcourue par la particule) avec la formule : d=v.t
-
La nature du support : texture…
Une fois que les protéines sont séparées, on introduit un colorant qui montre le profil caractéristique de bandes colorées de chaque protéine. Sur les bandes, on peut constater la quantité de protéines présentes, mais aussi la présence d'une protéine particulière. On construit ensuite un graphique en fonction du profil de bandes. On y voit plus clairement la quantité et le contenu de chaque protéine grâce à des pics verticaux plus ou moins élevés.
Grâce à l’électrophorèse, on peut donc distinguer les protéines MECP2, et les observer afin de voir si elles sont normales ou non. C’est donc une autre technique permettant de déterminer si un individu est atteint ou non du syndrome de rett. Cette technique n’est utilisée que pour confirmer la présence de cette maladie et non la découvrir.